« … pour Chomsky, la propagande est la réalisation d'un cadre adéquat à une opinion que quelqu'un souhaite imposer, notamment par l'usage de termes qui enferment le lecteur/auditeur dans une certaine réalité. » (Julien Longhi, hufftingtonpost, « Chomsky et la manipulation des masses » - 2013)
Un mot pour imposer l’existence d’un absolu
 La « vérité », c’est quand on n’a plus rien de très intéressant à dire, ni de très convaincant du reste. Le pire est que Noam Chomsky lui-même, recourt à ce mot : « C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. » D’ores et déjà me voici livré à la critique ; ce que j’entends dans « responsabilité » c’est « rôle », c’est à dire ce que nous sommes en droit d’attendre des intellectuels en question. Quant à la « vérité », de quoi s’agit-il ? De ce qui est, a été, en somme, de ce qui est ou a été observé, authentifié, d’aucuns diront « vérifié », oui, mais voilà ; ce participe passé employé comme adjectif tombe dans un puits, celui de la « vérité ».
La « vérité », c’est quand on n’a plus rien de très intéressant à dire, ni de très convaincant du reste. Le pire est que Noam Chomsky lui-même, recourt à ce mot : « C'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. » D’ores et déjà me voici livré à la critique ; ce que j’entends dans « responsabilité » c’est « rôle », c’est à dire ce que nous sommes en droit d’attendre des intellectuels en question. Quant à la « vérité », de quoi s’agit-il ? De ce qui est, a été, en somme, de ce qui est ou a été observé, authentifié, d’aucuns diront « vérifié », oui, mais voilà ; ce participe passé employé comme adjectif tombe dans un puits, celui de la « vérité ».
Vérité, vérifier, vérification, vrai, vraiment, véritable, avéré, véritablement etc … Une petite orgie de mots allant du verbe au substantif, depuis l’adverbe jusqu’à l’adjectif, de quoi pouvoir invoquer, conjurer, exorciser, objurguer, abjurer, condamner … mettre à mort ! Un mot terrible élevé à l’universalité et au culte de l’absolu, dont l’étymologie a de quoi interroger, interpeller, apostropher.
C’est en effet dans le champ du religieux qu’il convient de prendre acte de la survenue de ce mot dans le discours. Ce mot est identifié lors de la deuxième moitié du Xème siècle, pour traiter d’une opinion conforme à ce qui est, par opposition à l’ « erreur », ceci en matière de religion ! Il est promptement question, lors du début de ce premier millénaire, de valider l’existence du christ, sa résurrection et sa divinité. Blaise Pascal parlera plus tard des « vérités de l’évangile » (Pascal, « Les Provinciales », deuxième lettre – 1656) dans des lettres ouvertes visant à défendre un ami contre une censure à caractère théologique.
Plus tard, la science (pas la théologie), cette démarche censée s’occuper des faits et du réel, de ce qui est observable, authentifiable, quantifiable, reproductible, va s’enliser par l’usage du mot vérité pour valider ce qui est en mesure d’être cru par opposition à ce qui ne mérite pas de l’être. La vérité va devenir scientifique, dans un mouvement centrifuge, en répulsion de la pensée religieuse. Parmi le commun, quiconque plutôt agnostique, ou plus volontiers athée, pour ne pas dire carrément anticlérical, n’en utilisera pas moins l’élément de langage « vérité scientifique », en vue de mettre en exergue une démarche s’appuyant sur un protocole, la « méthode expérimentale ».
Ce qui est tenu pour vrai, voire pour faux, ne s’applique qu’à un discours
Sauf que la vérité, ça n’existe pas ! Parce qu’il n’y a PAS de vérité. Il n’y a que des réalités, des représentations du réel, qui tentent de concevoir et penser celui-ci qui se dérobe sans cesse à toute tentative de le circonscrire, en ce que toute conquête des sciences qui enrichissent notre connaissance du monde, repousse du même coup les limites de ce que nous avons et aurons à connaître. Ce qui est tenu pour vrai, voire pour faux, ne s’applique qu’à un discours, un énoncé. Ce qui est arrivé, ce qui s’est produit, ce qui a été observé, fait fatalement l’objet d’un récit, d’un discours ; il demeure que ce qui est rapporté doit être authentifié. Dût un fait accéder au statut d’authentique, il demeure un fait, souvent une agrégation d’événements dont les liens de causalité sont contestables. Les faits mêmes sont filtrés par nos sens, irrémédiablement limités, contaminés par toutes sortes de présupposés, hérités de nos représentations, elles-mêmes forgées par notre appartenance à un groupe, la famille, la classe, la société, dont les influences compromettent l’exactitude. Il est question ici du fossé quasi-irréductible entre ce qui d’une part, relève de la réalité, cette construction élaborée par nos perceptions et notre habitus, et d’autre part, le réel, qui renvoie à ce qui est ou a été, ce qui a eu lieu, dont nos sens ne peuvent saisir qu’une improbable totalité.
La vérité, c'est le mensonge
Si le mot vérité, assorti de tout son aréopage sémantique, tente de couper court à quelque objection, il y a aussi la corruption d’autres mots pour exercer une influence sur les représentations, les modifier en vue de faire admettre des réalités alternatives, destinées au profit d’une classe dominante, ou d’une minorité active engagée dans un processus de valorisation de son statut sociétal.
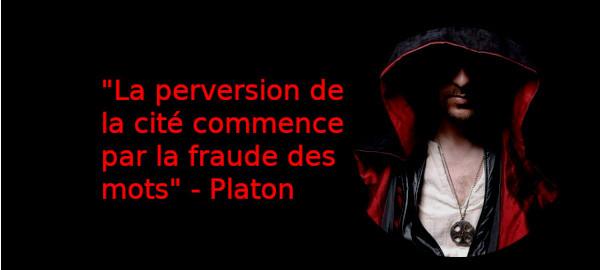
Dans son roman « 1984 », Georges Orwell tente une démonstration de ce en quoi consiste la corruption du langage et des effets qu’en attend un pouvoir totalitaire, l'Angsoc, sur la façon dont le populus se représente le monde. Orwell utilise le terme « novlang » pour désigner un langage dont certaines catégories de mots ont été supprimées, interdites par décret, cependant que certains autres mots sont vidés de leur dénotation initiale pour venir signifier autre chose, jusqu’à désigner le contraire : « La guerre c’est la paix. ». Ainsi, l'appauvrissement du vocabulaire conduit-il à celui de la pensée, exclut les nuances, oblige à raisonner de façon binaire, de sorte qu'il ne reste plus que la possibilité d'être pour ou contre quelque chose, à l'exclusion de toute position intermédiaire.
Invoquer la vérité revient à exclure, sans contrepartie, toute incertitude. Le mot vérité suppose une dichotomie fondamentale telle que ce qui n'est pas "vrai" est obligatoirement faux. Recourir à ce mot lors d'une discussion, "c'est la vérité", "il est vrai que ...", ne sert qu'à souligner l'existence ou la pertinence d'un phénomène au mépris de la diversité des appréciations dont il fait l'objet, et accessoirement, valoriser qui prétend détenir la manière dont il convient de considérer ce qui survient à l'observation, les faits comme les idées.
Glissement
Le glissement sémantique fait qu’un mot va se charger d’une connotation qu’il n’évoquait initialement pas. L’adjectif terrible deviendra, par exemple, durant les années soixante, le moyen de qualifier quelque chose de très positif car formidable, exceptionnel, désirable, génial, alors que le terme renvoie initialement à la peur, la terreur, ce glissement faisant ce mot plus proche de la surprise, bonne plutôt que mauvaise. « C’est terrible ! » Cet usage, daté, a laissé la place à « c’est super ! » ou « c’est génial ! ». On observera néanmoins que le fait d’avoir passé une super soirée, « c’était génial ! », n’a rien de particulièrement génial, sauf peut-être, le talent imputable aux organisateurs de l’événement.
Qu’en est-il du « travail », mot donné dès le XIIe siècle comme désignant tourment et douleur, devenant à la fin du XXe un droit, espérance ultime de personnes dépossédées d’une partie de leur citoyenneté, volontiers tenues pour des parasites sociaux entretenus par des subsides que d’aucuns leur reprochent, devenu (le travail) dans le discours d’élites nanties, une valeur. On ne s’en étonnera pas, dans le contexte d’une société encore marquée par la morale judéo-chrétienne qui entend que rien ne s’obtient sans l’avoir mérité par une forme de mortification. On pourra aussi s’interroger sur ce qu’est une valeur, dans ce cas précis, la pénibilité qui confère une valeur morale au travail.
Travestissement
Il est devenu ordinaire de se voir méprisé par l’emploi de mots désormais jugés péjoratifs, au motif qu’ils s’appliquent à des personnes, des populations, estimées par trop défavorisées, discriminées. Ainsi, depuis l’entre-deux guerres, on ne parle plus de vieillard, mais de vieux, pour finir par le vocable personne âgée, celui de retraité faisant office de terme censé désigner un virtuel « jeune vieux » car fraîchement délivré de son obligation de travailler. Dire qu’une personne est un(e) nain(e) n’est guère cosmétique, au point qu’il est devenu la règle de dire « personne de petite taille », d’un(e) handicapé(e), personne porteuse de handicap ou à mobilité réduite, selon le cas, d’un(e) mongolien(ne), trisomique, comme si cette nouvelle manière de les désigner conjurait quoi que ce soit de l’idée qu’on se fît de leur état. Un chômeur ou une chômeuse deviennent des demandeurs d’emploi ou en recherche de la même chose. Un patron est préférentiellement devenu chef d’entreprise à défaut de manager.
Le « mariage pour tous » aura été une façon de travestir ce que toute une société considérait comme un fait homo-sexuel, alors qu’il s’agissait plus simplement de parler de mariage homoconjugal, ce qui laisse penser que l’emploi de cet élément de langage, mariage pour tous, visait à protéger les personnes concernées de la connotation (exclusivement?) sexuelle, perçue comme telle, de leur désir de s’unir en mariage. Rien n’y fit apparemment ! On parle encore de mariage homo-sexuel, peut-être parce que les homos sont « sexuels », davantage que les hétéros, lesquels sont plutôt … romantiques. Certaines représentations ont la vie dure.
La pandémie de grippe chinoise (2019 – 2022) s’illustrera par l’emploi du terme « vaccin » pour désigner une solution injectable chargée avec des nucléotides dans leur version A.R.N. (Acide Ribo-Nucléique), le terme « complotiste » s’imposant pour qualifier toute personne refusant une telle désignation, étant entendu qu’un vaccin se comprend comme une solution contenant un agent infectieux dont la nocivité a été préalablement atténuée en laboratoire. C’est ainsi que ceux et celles qui refusèrent l’injection chargée en A.R.N. furent – et sont encore – brocardés du terme « antivax », au mépris de la confiance que la plupart d’entre-eux faisaient, et font encore à de nombreux vaccins dont l’efficacité a été démontrée, comme assurant réellement la protection contre des agents infectieux, en regard du risque très négligeable lié à leur usage.
Occlusion, le point de non retour
Qu’en est-il de la « vérité », parmi ces opérations sur le langage, spontanées ou calculées ?
Ce mot appelle une malédiction à l’endroit de tout ce qui peut déranger quiconque prétend détenir avec certitude une connaissance, une science de ce qui se doit d’être pensé et admis. Ce mot, hérité de cogitations à caractère théologique, veut imposer une fin de non-recevoir à toute discussion dans laquelle un des locuteurs, arc-bouté sur sa certitude, jette à la face de l’autre la validité de ses arguments, en ce qu’ils relèvent de LA vérité, au mieux « scientifique ».
Si l’avocat Mike Godwin brossa sa loi selon laquelle une discussion interminable n’aboutissant à aucun consensus, dérape sur des références au nazisme, ou à Adolf Hitler, avec une probabilité proche de 1, il est non moins probable que recourir à invoquer une vérité, LA vérité, peut se donner comme une conséquence de l’incompatibilité des points de vue des débateurs, respectivement incapables de formuler des arguments de nature à faire évoluer leur discussion vers ne serait-ce qu’un consensus partiel.
Le problème, avec la vérité, c’est que ce mot veut tout et rien dire, dans une étrange simultanéité. Tout, parce que l’invoquer présuppose la croyance, dans le mental de qui l’invoque, en un absolu, hypothétique, mais rien ni davantage, parce que la relativité de nos perceptions vient des limitations inhérentes à notre inaptitude à percevoir le réel, à savoir, ce que nos récepteurs sensoriels ne peuvent percevoir. Les mots nous permettent de conférer une existence à des phénomènes désormais revêtus d’un caractère concret qui les objective et les institue comme éléments de langage. Or, nommer quelque chose, c’est du même coup rejeter dans l’ineffable d’autres significations que cela pût revêtir. Invoquer la vérité, c’est rejeter ce qui la met en doute, c’est tout à la fois affirmer sa domination et se recroqueviller dans son habitus, vouloir démontrer l’impossible tout en se rassurant, alléguer l’existence d’un absolu, parfois pour chasser l’inconfort de l’incertain et du précaire.
Être ou avoir ?
En matière de fait, le verbe « être » s’emploie communément dans des expressions telles « ce qui s’est produit », « ce qui s’est passé ». Mais plus exactement, il s’agit – en matière de fait – de ce qui a eu lieu. Le verbe « être » fait ici figure de non-sens. Les événements ne « sont » pas. Les événements surviennent ; seuls les organismes vivants « sont ». Ils (les événements), ne sont pas des êtres vivants, en ce qu’ils surviennent, devenant objets pour qui les observe. L’idée même qu’ils « se » produisent laisse entendre leur immanence, leur survenue alors perçue comme voulue, dans un quelque part hypothétique. Dire « ça s’est passé », c’est spontanément admettre que « ça » a décidé de survenir, de « se » produire. Or, un fait doit exclusivement se comprendre comme un objet – et non pas comme un « être ». Un fait passe nécessairement par un processus, un travail, celui de l’interprétation. Parce ce qu’observé, il subit la représentation, inévitablement reconstruit, au risque de l’imaginaire. La vérité n’a rien de commun avec tout cela.
Conclusion
Insister sur la vérité, comme catégorie linguistique, c’est une façon d’affirmer l’existence d’un absolu, hypothétique, conjectural, fatalement douteux. Admettre le réel, comme adjectif substantivé et catégorie linguistique, c’est admettre le caractère approximatif et critiquable de la connaissance, tout particulièrement celle tenue pour admise, dénoncer la prétention de l’existence d’une vérité, en ce que celle-ci relève d’un procédé discursif de simplification de ce qui a lieu, dans un univers autrement plus complexe que celui auquel croient certains penseurs superficiels. Pire, admettre le réel comme catégorie, c’est risquer de connaître parfois la survenue de l’angoisse que provoque l’idée d’un au-delà inquiétant, parfois terrifiant, parce qu’ ineffable.
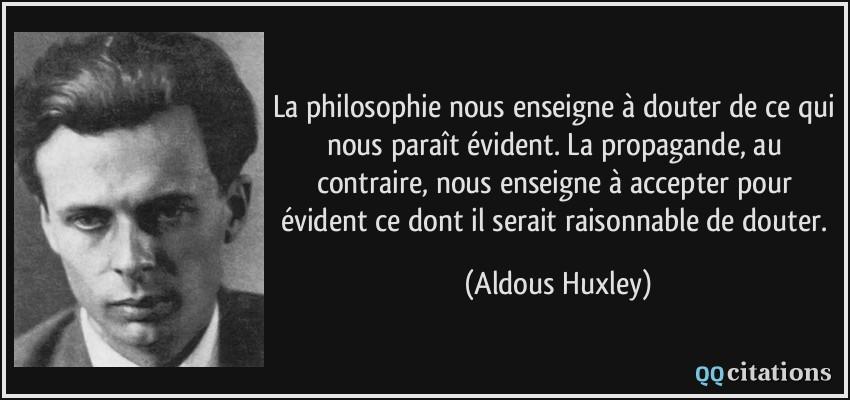
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
