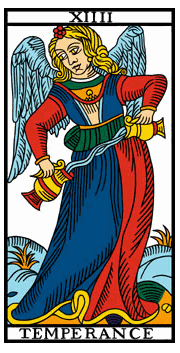Fabriquer une matière cireuse pour y cheviller des senteurs qui s'exhaleront ensuite depuis notre peau ne représente guère de difficulté. Il y a différentes manière de faire. Le procédé reste néanmoins assez standard : de la cire, une huile neutre, des huiles essentielles, le tout délicatement mitonné au bain marie. C'est du moins la manière la plus courante.
Fabriquer une matière cireuse pour y cheviller des senteurs qui s'exhaleront ensuite depuis notre peau ne représente guère de difficulté. Il y a différentes manière de faire. Le procédé reste néanmoins assez standard : de la cire, une huile neutre, des huiles essentielles, le tout délicatement mitonné au bain marie. C'est du moins la manière la plus courante.
Matières
La cire peut être celle d'abeille ou toute autre cire végétale dont il faudra évaluer pour chacune le pouvoir aromatique natif susceptible d'affecter la fragrance recherchée.
Les huiles de macadamia, jojoba, carthame, d'amande douce ou de noyau d'abricot conviennent car elles sont très neutres et présentent l'avantage de prévenir un toucher trop gras sur le corps.
Les matières odorantes peuvent être des huiles essentielles (ylang, vétiver, nard, néroli ...), des macérats huileux concentrés en matières végétales de plantes aromatiques (géranium, rose, romarin, laurier noble ...), bois divers (cannelle, santal, cade, cèdre ...), mais aussi résines (myrrhe, oliban, storax, copal ...) sans oublier les écorces d'agrumes (mandarine, orange, citron, pamplemousse, cédrat, lime, bergamote ...).
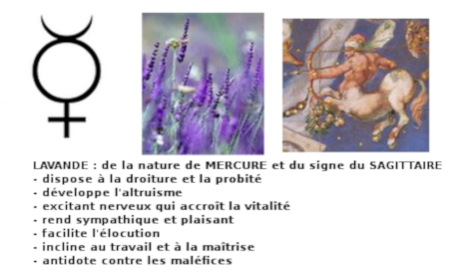
Proportions
Les proportions sont de l'ordre de 7 parts de matière huileuse pour 3 parts de matière cireuse. Le plus simple et rapide paraît tenir dans la mise en oeuvre d'huiles essentielles assez facilement accessibles dans des magasins bio ou des pharmacies. Il est évidemment possible de créer soi-même les macérats odorants quand on connaît les plantes et que l'on peut les trouver dans la nature ou le jardin : thym, romarin, sauge, rose, géranium, laurier noble, origan, calament ... Mais cela est moins rapide, mobilise un peu de matériel et suppose de faire de sa cuisine un petit laboratoire sans nécessairement contraindre les fonctions alimentaires.
L'usage d'une graisse déjà figée comme un beurre (de cacao, karité ...) permet des proportions de 2 parts pour une seule de cire, ce qui devrait donner une concrète de correcte tenue.
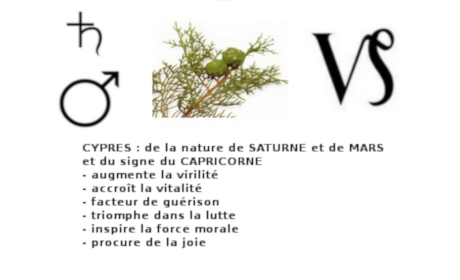
Stabilisation, conservation
L'usage d'un conservateur ajouté en fin de préparation lorsque le macérat a reposé après le bain marie est recommandé. La vitamine E est la solution la plus fréquente ; l'extrait de pépin de pamplemousse passe pour un stabilisant efficace. La combinaison des deux permettrait de conserver un parfum solide fait maison sans le réfrigérer. Le benzoate de sodium (E211) peut faire l'affaire puisqu'il en faut très peu à raison 0.5%. Certaines huiles essentielles et/ou matières végétales sont par nature fongicides comme le girofle, la lavande, le géranium. Des propriétés bactéricides sont connues chez d'autres comme l'origan, le thym, le romarin, la sarriette, la cannelle pour ne citer qu'eux. L'extrait de propolis est aussi une bonne idée. Ces propriétés entrent donc en synergie de celles des conservateurs envisagés.
L'usage de conservateurs vise notamment à éviter le développement de la toxine botulinique, poison radical s'il en est !
Correspondances pratiques
H.E. -> Huile Essentielle
mv -> masse volumique ou densité
1ml H.E. = 35 gouttes environ = 0.8 mg environ
La densité ou masse volumique d'un corps liquide est un paramètre à considérer. Si dans le cas de l'eau il est standard de poser :
1ml = 1mg
1ml H.E. < 1 mg soit 0.8 mg environ, car une huile est moins dense que l'eau, ce qui se traduit par le fait qu'une huile surnage sur l'eau parce qu'elle est plus "légère".
huile : mv = 0.8 à 0.9
alcool : mv = 0.79
beurre : mv = 0.91
huile olive : mv = 0.92
cire d'abeille : mv = 0.95
glycérine : mv = 1.26
miel : mv = 1.42
Lorsqu'une recette délivre des quantités en poids, il est utile d'envisager que :
1 cuil. à café = 5 ml environ
1 cuil. à soupe = 20 ml environ
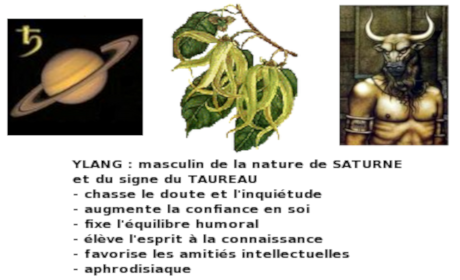
Macérat huileux
Réaliser des macérations à partir d'un mélange de matières végétales odorantes ou même d'une seule matière première pour mélanger les huiles parfumées ensuite est une solution intéressante. Le procédé est d'une grande simplicité et sans danger du moment qu'on se soucie de la stérilisation du contenant, par exemple un bocal à conserves type "le parfait" avec joint en caoutchouc (nettoyer avec du Dakin Cooper puis mettre à bouillir 20 minutes).
Disposer les matières au fond du bocal, tasser, puis recouvrir d'une huile neutre de sorte à ce qu'il s'y trouve 3 parts de matière odorante pour 4 parts d'huile. Il est souhaitable que le niveau d'huile dépasse celui des matières car beaucoup d'entre elles vont tendre à absorber l'huile ce qui en fera baisser le niveau. Dans ce cas il faudra en rajouter.
L'usage d'un conservateur est conseillé à raison de 0.1 à 0.2 % pour 100 ml soit 2 à 4 gouttes pour de la vitamine E ; pareil pour le benzoate de sodium. On peut les porter à 0.5 % pour être plus sûr. Les clous de girofle contiennent naturellement du sodium benzoate. Quant à l'origan, c'est un antibiotique à large spectre qui tue efficacement un très grand nombre d'agents infectieux en détruisant leur membrane cellulaire ; c'est un antimicrobien, antiviral, fongicide, bactéricide et mycobatéricide ! Son odeur aromatique, verte, sèche et agreste, lui donne toute sa place dans une composition soit comme matière première ou à raison de 2 à 4 gouttes d'H.E. pour 100 ml.
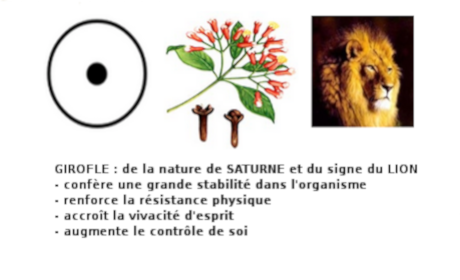
Macération à chaud ou à froid ?
À froid, cela prendra 3 à 4 semaines voire davantage.
À chaud c'est plus rapide et se fait au bain marie, à feu très doux pendant quelques heures, de 2/3 à 5/8 heures, en veillant à maintenir une température juste inférieure ou égale à 40°C. On trouve à cet effet des sondes dans le commerce.
Les Romains faisaient cela dans des pots en terre vernissée bouchés avec du liège et laissaient les préparations macérer des semaines durant. L'usage de ce type de pot est une bonne idée en ce qu'il est opaque et protège des dégradations dues à la lumière. Quant à la terre, voici un matériau noble pour contenir une huile en voie de se parfumer avec les précieux arômes qui diffuseront leur magie à l'air libre.
La méthode mixte, c'est de commencer à chaud puis de continuer à température ambiante, à l'abri de la lumière pendant quelques semaines à 2 mois.
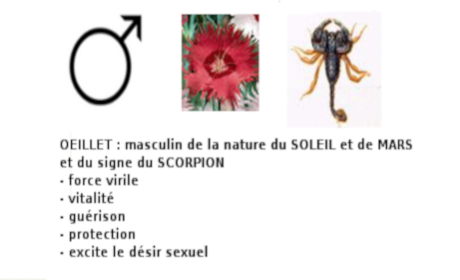
Pyramide olfactive
Le parfum matières odorantes s'exhale plus ou moins rapidement selon sa nature chimique. Certains fuient plus vite la source tels ceux des agrumes, des menthes, des fruits, alors que d'autres sont chimiquement plus lourds ; ils s'exhalent plus lentement. Ce sont ces molécules plus lourdes qui font de certaines matières olfactives des "fixateurs" car elles retiennent celles plus volatiles. Girofle, vétiver, santal, patchouli, sauge sclarée, fève tonka, mousse de chêne, bois de cèdre sont souvent utilisés comme fixateurs.
Les parfumeurs distinguent trois strates dans la construction d'un parfum :
En tête, les senteurs vives et volatiles issues des agrumes et de certaines fleurs ou plantes comme la bergamote, la menthe, la lavande, l'anis ... caractérisées par leur fragrance fraîche, aromatique, vive.
Dans le coeur, des fleurs comme la rose, le lilas, des feuilles comme celle de figuier, de romarin, des odeurs de fruits comme la pêche, la mangue, des herbes comme l'armoise ou donnant des odeurs de foin séché ... à la fragrance fleurie, fruitée, verte ou volontiers épicée.
Le fond, le plus souvent assuré par des bois, des résines, de la racine d'iris ou de vétiver, du patchouli, du santal, du cèdre ... donnant aux senteurs un caractère boisé, résineux, balsamique, terreux.
Un parfum se doit de faire figurer un ou plusieurs représentants de chaque strate dans sa composition. La pyramide olfactive est un modèle à considérer en vue de produire une forme pertinente.
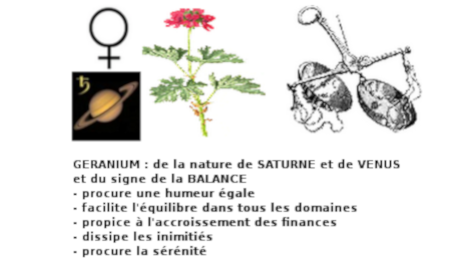
liens :
Fabriquer son macérât huileux chez lestrappeus.es
Fabriquez vos produits à base de plantes chez altheaprovence.com
Rejoignez-moi chez Mastodon ou Piaille ou Ravenation ou XYZ ou Mamot