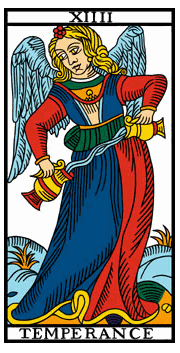Du doute et de la vérité
Classé dans : Psychologie, Philosophie - Mots clés : science, doute, vérité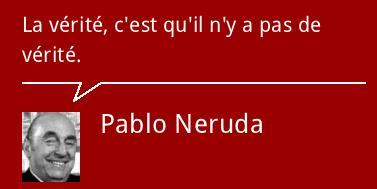
De la vérité
 Elle est avant tout une notion à caractère philosophique. Elle est un mot et n'est que cela, un mot qui n'a pas de pluriel. Seuls les faits peuvent être "vérifiés" ; seules les investigations dont ils font l'objet visent à établir la preuve de leur survenue. Or, la vérité n'a aucun rapport avec les faits, mais avec les opinions et les croyances. La vérité relève de la norme, du dogme, de la doctrine. La vérité est un produit culturel dont la fonction est de donner du sens au monde dans lequel nous vivons, évoluons, participons. Instaurée comme paradigme de ce qu'il convient ou non de croire, elle s'impose comme cadre dans et par lequel l'individu social organise ses perceptions, adopte ses valeurs, élabore ses représentations, construit sa réalité.
Elle est avant tout une notion à caractère philosophique. Elle est un mot et n'est que cela, un mot qui n'a pas de pluriel. Seuls les faits peuvent être "vérifiés" ; seules les investigations dont ils font l'objet visent à établir la preuve de leur survenue. Or, la vérité n'a aucun rapport avec les faits, mais avec les opinions et les croyances. La vérité relève de la norme, du dogme, de la doctrine. La vérité est un produit culturel dont la fonction est de donner du sens au monde dans lequel nous vivons, évoluons, participons. Instaurée comme paradigme de ce qu'il convient ou non de croire, elle s'impose comme cadre dans et par lequel l'individu social organise ses perceptions, adopte ses valeurs, élabore ses représentations, construit sa réalité.
La croyance en l'existence de la vérité répond à un besoin fondamental de sécurité ; cette croyance dans le même temps abaisse la conscience d'autres possibles. Il s'agit pour les êtres humains de se forger une représentation du monde qui soulage l'angoisse que le monde ne soit qu'un chaos irréductible, incohérent et indécryptable.
"Nous", comme individus socialisés, sommes enclins à nommer "vérité" la description exacte de ce qui se produit, objectivement observé, Mais l'objectivité n'est qu'une attitude, une prédisposition à penser et agir. Rien ne peut garantir que le témoignage de ce qui a été observé soit exempt des inclinations personnelles du ou des observateurs. La croyance en l'authenticité d'un fait, rapporté par un ou plusieurs témoins tenus pour objectifs, supposés dignes de confiance, fait naître l'illusion de LA vérité : "Cela s'est passé ainsi, à tel endroit, impliquant telles personnes ... etc ...". Par glissement sémantique, le mot "vérité" vient s'appliquer à quelque chose donné pour authentique - et authentifiable - décrit par des témoins tenus pour dignes de confiance. "C'est la vérité."
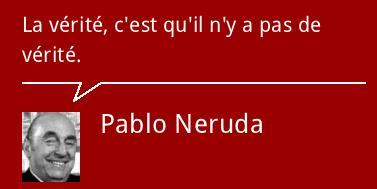 La vérité est une illusion.
La vérité est une illusion.
Relater un fait est indissociable de la motivation à en faire le récit. Ce qui est vérifiable est-il véritable ? Pour autant que la vérité soit un postulat, un dogme, aucun fait ne peut relever de LA vérité, tout au plus la circonscrire, se donner comme un élément parmi d'autres, nombreux, qui le contextualisent et en font un objet de mise en perspective d'un phénomène nécessairement plus complexe. Affirmer que quelque chose est vrai se conçoit aisément dans les sciences physiques et/ou mathématiques. Si 1+1=2, et si cela est "vrai", ce n'est en aucun cas LA vérité, en ce que cette affirmation n'est qu'une étape, en tout cas une prémisse du fait qu'il existe une cohérence dans l'ensemble des nombres. La mathématique est parmi les sciences une de celles qui ordonne le chaos jusqu'à le théoriser ! Son objet n'est pas les croyances, bien que certaines de ses applications peuvent nous informer sur le fonctionnement de nos motivations et biais cognitifs.
Du doute
Le doute est une attitude, c'est à dire une prédisposition à agir (G.W. Allport - 1935). Le doute est tributaire de facteurs psychologiques et environnementaux. Telle assertion, telle expérience, sont de nature à susciter le doute. L'état de dissonance cognitive - incompatibilité entre des croyances ou des comportements - peut être de nature à provoquer le doute. Selon les individus, il est vécu plus ou moins intensément et de très diverses manières, depuis la motivation à réfléchir jusqu'à l'angoisse existentielle. Qu'on ne s'y trompe pas, ces deux modalités s'interpénètrent ; le doute ne peut se donner comme une posture confortable à long terme, le besoin de cohérence l'emportant sur le goût de la réflexion et de la recherche. Le doute survient dans un contexte psychosocial, individuel ou collectif, d'ores et déjà formaté par des représentations qui lui pré-existent.
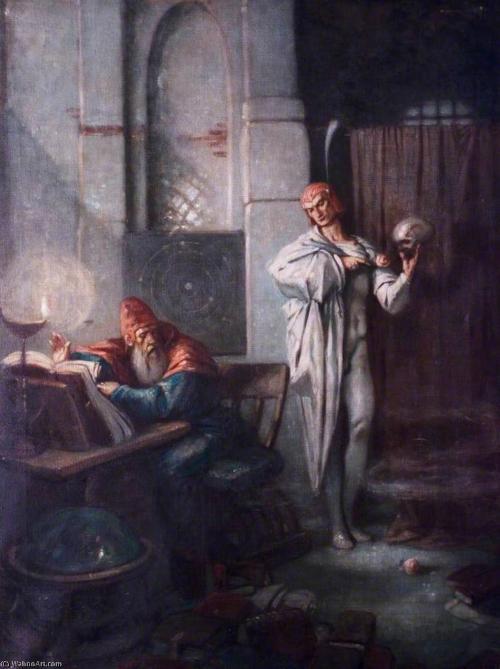 Qu'il s'agisse de science ou de spiritualité, et quoique le doute soit une inclination à faire progresser la connaissance du monde, il vient un temps où la stratification des connaissances acquises voit se former des certitudes. Il est en effet fréquent - par une simple analyse de contenu - de les identifier dans les argumentations de "sachants". Il est tout à la fois terrible et navrant pour un sceptique de voir combien la croyance en un seul dieu est plus rassurante et tranquillisante que de savoir que notre planète est une sphère qui vogue en tire-bouchon dans l'espace intersidéral, constat qui ne rassure ni n'angoisse quiconque (enfin... cela dépend de qui !). Seule la prestidigitation (de "prestige" et "doigté"), suscite un doute goûté avec amusement, tentation peut-être, mais qui n'inquiète pas et n'a pas davantage vocation à le faire.
Qu'il s'agisse de science ou de spiritualité, et quoique le doute soit une inclination à faire progresser la connaissance du monde, il vient un temps où la stratification des connaissances acquises voit se former des certitudes. Il est en effet fréquent - par une simple analyse de contenu - de les identifier dans les argumentations de "sachants". Il est tout à la fois terrible et navrant pour un sceptique de voir combien la croyance en un seul dieu est plus rassurante et tranquillisante que de savoir que notre planète est une sphère qui vogue en tire-bouchon dans l'espace intersidéral, constat qui ne rassure ni n'angoisse quiconque (enfin... cela dépend de qui !). Seule la prestidigitation (de "prestige" et "doigté"), suscite un doute goûté avec amusement, tentation peut-être, mais qui n'inquiète pas et n'a pas davantage vocation à le faire.
Toute motivation à dissiper le doute concernant tel fait, telle connaissance ou telle croyance, se doit d'être considérée et étudiée comme on le ferait pour identifier et décrire une réaction chimique. La vérité procède du doute, non l'inverse. Une disposition mentale, un état d'esprit, peuvent être identifiés et connus avec suffisamment de précision. Considérer que le doute procède de la vérité revient à dire que la croyance en la vérité produit le doute, ce qui d'un point de vue purement rationnel et scientifique est ... douteux ! C'est cependant ce qui se passe le plus souvent et vient à introduire des biais cognitifs dans la production de la connaissance pure d'un fait, par des recherches dont les protocoles sont criticables et les conclusions erronées ou spécieuses.
De la motivation
Le problème de la recherche aujourd'hui semble être que pour réaliser une analyse objective, il faut lui fournir les objectifs pour faire l'analyse !
Le doute est une attitude. Douter est une motivation, celle de valider ou d'invalider une connaissance, une information ou une observation tenues pour suffisamment remarquables en vue de les tenir pour valides, justes et exempts d'erreur ou de corruption. Le propre de la démarche scientifique est de s'appuyer sur des faits incontestables, unanimement reconnus. Cependant, Si rien ne s'oppose - objectivement - à proposer une hypothèse, rien ne saurait justifier de méconnaître ce qui la motive, ni l'état d'esprit de celui ou celle qui la propose.
La motivation est un mouvement dirigé vers un but. Elle est indissociable du doute qui dispose à authentifier la validité de la connaissance ainsi que les moyens par lesquels elle est produite ; autrement dit, que ni telle connaissance ni le moyen mis en oeuvre pour la valider ne puissent être mis en doute. Ainsi, il est possible de constituer une heuristique permettant de poursuivre le décryptage des mécanismes l'ayant produite ainsi que ceux du fonctionnement du monde. Il s'agit ici de la perspective adoptée pour envisager la relation entre le "facteur humain" et la perception du "réel".
 La motivation à chercher, et donc à douter, de ce qui est, ou n'est pas, de la cohérence et de la consistance des connaissances, de leur validité, permettant d'établir comme un fait qu'il y a une cohérence dans la survenue d'autres faits, va donc bien au delà de l'authentification de ce qui se produit dans le "réel". La production de connaissance peut-elle fabriquer le "réel", ce dernier devenant alors un artefact ? Mais le réel est ineffable, irréductible à la réalité, trop souvent confondue avec lui, et la connaissance fatalement en deçà du réel.
La motivation à chercher, et donc à douter, de ce qui est, ou n'est pas, de la cohérence et de la consistance des connaissances, de leur validité, permettant d'établir comme un fait qu'il y a une cohérence dans la survenue d'autres faits, va donc bien au delà de l'authentification de ce qui se produit dans le "réel". La production de connaissance peut-elle fabriquer le "réel", ce dernier devenant alors un artefact ? Mais le réel est ineffable, irréductible à la réalité, trop souvent confondue avec lui, et la connaissance fatalement en deçà du réel.
La pensée magique est emblématique de cela même qui tient à croire que la pensée est créatrice, que la volonté est de nature à produire des manifestations qui échappent à la logique la plus rigoureuse. "Paranormal" est le terme consacré pour désigner cela. En outre, ce terme a été créé pour satisfaire qui ne croit pas à ce qui est illogique ou irrationnel, mais satisfait aussi qui croit que le possible ne se limite pas à ce que croient les sceptiques. Ceux-ci, les sceptiques, estiment précisément que les tenants de la pensée magique fabriquent le réel, en tout cas le fantasment. La motivation des autres à réenchanter le monde n'a guère grâce dans les milieux scientifiques ni aux yeux de ces néo-rationalistes qui se nomment "zététiciens", affairés à protéger le bon peuple de l'imposture.
discussions passionnées et houleuses autour des sciences conjecturales et autres mancies, où l'injure tient lieu d'indicateur de phase terminale
On se souviendra de l'hystérisation du débat concernant l'astrologie qui atteignit son paroxysme avec la parution du bouquin "L'astrologie" de Paul Couderc (Presses Universitaires de France - 1951), édition six fois mise à jour jusqu'en 1978, trois ans avant la disparition de cet astronome résolument scientiste. Son premier argument majeur fut de dénoncer l'erreur fondamentale des astrologues par la mise en exergue de la précession des équinoxes, laquelle invalidait de fait selon lui le zodiaque tropique en usage par eux car ne correspondant plus aux constellations réelles. On vit alors des astrologues s'engager dans la voie d'une astrologie "sidérale" en vue de revêtir cette vieille science d'un sérieux qui ne fut pas davantage agréé par la communauté scientifique.
Considérant l'issue des discussions passionnées et houleuses autour des sciences conjecturales et autres mancies, où l'injure tient lieu d'indicateur de phase terminale, il est non moins remarquable qu'elles s'attachent à conclure par la dénonciation d'impostures dont l'aspect financier l'emporte sur celle du manque de rigueur scientifique. Il en est très souvent ainsi du rapport qu'un grand nombre de scientifiques entretient avec les "charlatans" plutôt qu'avec leurs outils de travail.
Autrement dit, il semble que ce qui révulse d'honnêtes hommes ou femmes de science, c'est finalement le marché. Lorsque les arguments ne suffisent plus à convaincre, on dérape, outre l'injure, dans le hors sujet, principalement dans des questions gluantes de gros sous dont la viscosité n'a plus rien de très scientifique.
"Vérité", un mot à tiroirs
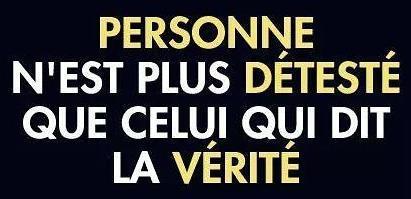 Il suffit de renseigner le champ d'un moteur de recherche avec les mots "citations" et "vérité" pour obtenir un florilège de maximes ou sentences proverbiales plus idiotes les unes que les autres, et ce malgré la tentative de leurs auteurs à les fleurir par des formules poétiques et une syntaxe élégante. On peut alors se rendre compte de la diversité des représentations que ce mot-dit éveille dans des consciences probablement tracassées.
Il suffit de renseigner le champ d'un moteur de recherche avec les mots "citations" et "vérité" pour obtenir un florilège de maximes ou sentences proverbiales plus idiotes les unes que les autres, et ce malgré la tentative de leurs auteurs à les fleurir par des formules poétiques et une syntaxe élégante. On peut alors se rendre compte de la diversité des représentations que ce mot-dit éveille dans des consciences probablement tracassées.
Tout cela a de quoi susciter le doute ! En effet, qui peut croire que les scélérats les plus sombres ne fussent des menteurs ou des égarés, sinon d'autres scélérats ?
Conclusion
Si en ce vingt-et-unième siècle, la voyante de quartier se substitue encore au prêtre ou au psychologue, c'est probablement aussi que les sciences dites exactes ne sont pas parvenues à délivrer suffisamment de réponses concrètes et utiles à nombre de personnes pour les aider à conduire efficacement leur vie. Le cadre conceptuel qu'elles proposent pour appréhender le fonctionnement du monde est confronté au doute issu de l'insatisfaction de populations qui ont cru à la toute puissance de la pensée scientifique, attendu qu'elle apporte des solutions efficaces pour lutter contre les maladies et la dégradation des conditions de vie sur notre planète. Depuis quelques décennies, un discrédit croissant frappe la recherche scientifique au motif que ses avancées semblent ne profiter qu'à des lobbies et actionnaires de grandes entreprises organisées en consortiums internationaux.
Encore des histoires de fric !
Rejoignez-moi chez Mastodon ou Piaille ou Ravenation ou XYZ ou Mamot